Bonjour,
BDSM: Consentement, pouvoir et domination
A côté de ce que certains nomment désormais le «sexe vanille», une pratique érotique dans les clous, le BDSM exerce une curiosité toujours plus grande, avec son esthétique, ses séries télé, ses écoles spécialisées… Et si la société exorcisait gaiement ses pratiques punitives longtemps exercées sous la contrainte? Décryptage, à l’heure où deux historiennes publient un essai majeur sur le droit de correction.

Julie Rambal

Le BDSM exerce une curiosité toujours plus grande, avec son esthétique, ses séries télé, ses écoles spécialisées.
Amina Belkasmi«Le pouvoir est une responsabilité, pas un privilège», lance l’actrice Nana Mensah, alias Mistress Mira, à son auditoire d’aspirantes dominatrices bardées de latex, avant qu’un fétichiste déguisé en dalmatien ne vienne à quatre pattes réclamer des ordres. La scène se passe dans la série «Bonding», sur Netflix, qui narre les pérégrinations d’une New-Yorkaise étudiante en psychologie le jour et maîtresse SM la nuit, recrutant son meilleur ami homosexuel pour lui servir de garde du corps. Cette sitcom directement inspirée de la jeunesse de Rightor Doyle, créateur de la série, ouvre de manière joyeuse à l’univers du BDSM. Ici, les donjons sont roses et les hommes souvent en position de soumission, une représentation rare à l’écran… D’ailleurs Netflix vient de lancer une nouvelle série sur le thème, cette fois en provenance de Corée du Sud, baptisée «L’amour en laisse».

Le harnais: initialement prévu pour y attacher une laisse, le harnais est l’un des accessoires de la culture gay. En 1983, le groupe Frankie Goes to Hollywood lui rend hommage dans son clip Relax, qui met en scène un club BDSM. A l’époque, la BBC censure la vidéo. Désormais, l’acteur Timothée Chalamet arbore un harnais Vuitton aux Golden Globes…
Axelle/Bauer-Griffin
Le harnais: initialement prévu pour y attacher une laisse, le harnais est l’un des accessoires de la culture gay. En 1983, le groupe Frankie Goes to Hollywood lui rend hommage dans son clip Relax, qui met en scène un club BDSM. A l’époque, la BBC censure la vidéo. Désormais, l’acteur Timothée Chalamet arbore un harnais Vuitton aux Golden Globes…
Axelle/Bauer-GriffinEt soudain le BDSM est partout! Sous forme de combinaisons cloutées dans les clips des chanteuses pop, sur le réseau TikTok avec la nouvelle communauté KinkTok, qui joue du fouet et du martinet dans de courtes vidéos humoristiques, et jusque sur Kim Kardashian, récemment aperçue harnachée d’un masque sadomaso recouvrant entièrement son visage à la sortie d’un cinq-étoiles… A l’origine, le BDSM – acronyme de bondage (attacher), discipline et SM (pour les pratiques liées à la douleur) – désigne un ensemble de pratiques qui mettent en jeu une sexualité verticale. Et si le BDSM fascine tant, c’est peut-être parce qu’il sonde les tréfonds du consentement, en pleine ère «#MeToo»…

Eugénie Guillou: née en 1861, morte en 1930, Eugénie Guillou fascine toujours pour son destin hors norme. D’abord religieuse, éduquée aux pénitences, elle quitte les ordres et se met à pratiquer son art de la flagellation dans les clubs de fessée de la Belle Epoque. Son passé au couvent lui assure un grand succès.
Wikicommons, Daniel Grojnowski/éd. Pauvert
Eugénie Guillou: née en 1861, morte en 1930, Eugénie Guillou fascine toujours pour son destin hors norme. D’abord religieuse, éduquée aux pénitences, elle quitte les ordres et se met à pratiquer son art de la flagellation dans les clubs de fessée de la Belle Epoque. Son passé au couvent lui assure un grand succès.
Wikicommons, Daniel Grojnowski/éd. Pauvert«Vous ne pouvez pas évoquer le BDSM sans parler de consentement», confirme Zoé Blanc-Scuderi, sexologue et fondatrice de Sexopraxis, un centre de thérapies et d’ateliers pour explorer ses désirs, à Lausanne. «Car même si ce type de pratiques peut faire peur de l’extérieur, il faut savoir qu’avant toute séance les partenaires se sont mis d’accord de manière explicite et précise. Il existe même des check-lists et de nombreux systèmes de sécurité, tels que le «safe word» pour savoir si l’on s’approche d’une limite durant la séance. Le consentement est une condition sine qua non du BDSM. Sinon, c’est une agression.»
Sur Instagram, le hashtag «#bdsmcommunity» (la communauté BDSM) affiche 2,7 millions de publications, tandis que les cours de «shibari», cet art japonais d’attacher un corps avec des cordes, se développent. Stéphanie Doe, sexothérapeute et formatrice en sexualités alternatives, anime ses propres ateliers, ainsi que des cours de BDSM pour les couples «qui ont envie d’acquérir les apports théoriques afin de se lancer en sécurité». Pour elle aussi, le BDSM est un bon outil pour «questionner les normes et dynamiques d’échanges, dans une société déjà régie par des rapports de pouvoir et de domination, la plupart non consentis». Mais elle tempère sur le consentement: «Il n’est pas toujours clair dans ce milieu-là non plus. Et même si, sur le papier, tout est très contractualisé, il arrive de croiser des personnes qui ne vont pas bien, ou qui sont réellement sadiques, au sens étymologique du terme, et qui peuvent prendre du plaisir à infliger une souffrance non consentie. Certaines personnes pensent parfois s’orienter vers le BDSM par choix d’une sexualité récréative, alors qu’elles y vont plus dans une forme de conditionnement à un vécu. Personnellement, je propose des ateliers où l’on vient surtout se découvrir, se questionner, être maître de son désir et apprendre à dire non, aussi.»

Le latex: matière chérie des fétichistes (il faut dire qu’on a chaud dedans), le latex est très prisé par la mode (ici Nicki Minaj au MTV Awards 2017) dès les années 1970. Mais depuis la pandémie, c’est une explosion dans la haute couture, alors que les stars jouent les Domina à tous les galas. Une réaction à la soumission des confinements, selon un spécialiste interviewé dans le Guardian.
Jeff Kravitz
Le latex: matière chérie des fétichistes (il faut dire qu’on a chaud dedans), le latex est très prisé par la mode (ici Nicki Minaj au MTV Awards 2017) dès les années 1970. Mais depuis la pandémie, c’est une explosion dans la haute couture, alors que les stars jouent les Domina à tous les galas. Une réaction à la soumission des confinements, selon un spécialiste interviewé dans le Guardian.
Jeff KravitzAu commencement était la correction. Une coercition seulement destinée à dresser, éduquer, corriger ou punir, à laquelle les historiennes Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset consacrent un passionnant «Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir», qui vient de paraître aux Editions PUF. Signe de son incroyable banalisation, ce «droit de correction» impliquant la violence physique et parfois psychologique dans la sphère privée, au nom du maintien de l’ordre social, n’avait jamais eu son histoire. Dans leur somme composée de 248 notices («Bonnet d’âne», «Cachot monastique», «Camisole», «Fessée patriotique», «Magistrature paternelle»…), à laquelle ont contribué 164 spécialistes, Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset en dressent un état minutieux, de l’Antiquité à nos jours.
«De toutes les bêtes sauvages, c’est l’enfant qui est la plus difficile à manier», écrivait ainsi Platon, à une époque où l’on avait recours aux verges, des branches dures reliées entre elles, pour mieux «dresser». Au XVIIe siècle, le prêtre et pédagogue Pierre Fourier en recommande toujours quelques coups pour mater la désobéissance des écolières. Un siècle plus tard, le martinet a pris le relais. Il est toujours présent dans un foyer sur cinq au milieu des années 1970. Ce sont alors les femmes qui l’utilisent en majorité, «plus présentes dans l’éducation».
Aujourd’hui, les châtiments corporels ont été remplacés par le «privé de dessert, de télévision ou de console», observent les historiennes, dont l’ouvrage rappelle que le droit de correction ne concernait pas uniquement les enfants mais pouvait aussi s’exercer du mari sur l’épouse, de l’aîné sur le cadet, de la famille sur l’animal domestique, des maîtres sur les esclaves, ou encore dans les communautés religieuses…

Le masque: les masques n’ont jamais cessé de servir les jeux érotiques. Au carnaval de Venise, il permettait de s’enhardir anonymement. Dans le BDSM, il isole, pour mieux se concentrer sur les sensations. Cette version cuir ou latex séduit la mode. L’acteur américain Evan Mock présentait ainsi un modèle revisité du créateur Thom Browne au Met Gala 2021.
John Shearer
Le masque: les masques n’ont jamais cessé de servir les jeux érotiques. Au carnaval de Venise, il permettait de s’enhardir anonymement. Dans le BDSM, il isole, pour mieux se concentrer sur les sensations. Cette version cuir ou latex séduit la mode. L’acteur américain Evan Mock présentait ainsi un modèle revisité du créateur Thom Browne au Met Gala 2021.
John Shearer«L’exercice du droit de correction était disséminé au sein de la sphère domestique. En fonction des rôles, des situations, de l’âge et de la façon de progresser socialement, chacun en avait une part. Ainsi, l’épouse subit la violence de son mari, mais corrige ses enfants», observe Elisabeth Lusset. Ce droit était également admis car il était un devoir moral: «Un parent ne corrigeant pas son enfant désobéissant ou un mari sa femme indocile étaient considérés comme négligents, car ils ne leur enseignaient pas les normes de comportement pour vivre en société, et surtout faire leur salut. Certains prétendent encore que c’est parce qu’ils ont reçu des gifles qu’ils n’ont pas mal tourné.»
Cette coercition montre surtout à quel point «la sphère domestique reste un endroit où, au fond, il était normal qu’une certaine dose de violence s’exerce pour maintenir l’ordre, ajoute Isabelle Poutrin. D’ailleurs, de nos jours, les partisans de la fessée disent encore: «On a le droit d’éduquer nos enfants comme on l’entend.» Mais le privé n’échappe pas au politique.» D’ailleurs, l’histoire retient que la société s’est aussi interrogée sur des formes de châtiment «juste», tandis que ses détracteurs n’ont jamais manqué. Au XVIe siècle, Erasme décrit ainsi son souvenir de l’école: «On n’y entend que claquements des férules, sifflements des verges, hurlements et sanglots, menaces atroces. Qu’y apprennent les enfants sinon la haine de l’instruction?» C’est également la critique de la correction qui ouvre le champ à son érotisation, alors que le poids des ordres religieux commence à être vivement dénoncé.
«Au XVIIe siècle, des traités médicaux prétendent que la flagellation sur les reins peut guérir l’impuissance masculine dans le cadre d’une sexualité conjugale. Des polémistes vont utiliser ces traités pour décrédibiliser les ordres monastiques et affirmer que les religieuses et religieux ne cherchent pas simplement la pénitence, mais le plaisir à travers l’autoflagellation, raconte Elisabeth Lusset. C’est la convergence de mouvements polémistes, philosophiques et littéraires libertins qui font que l’on se met alors à associer pratique du fouet, de la discipline, puis de la fessée à des pratiques érotiques.» Avec l’essor des romans libertins et maisons spécialisées…

Le shibari est l’art d’attacher avec n’importe quoi (même du sparadrap), tandis que le kinbaku se réfère directement aux jeux érotiques très codifiés avec des cordes. Et si l’actrice et réalisatrice Asia Argento n’hésite pas à poser ficelée sur son Instagram, d’autres, comme Iris Law, la fille de Jude Law, préfèrent l’allusion discrète au bondage avec des robes couture.
Daniele Venturelli
Le shibari est l’art d’attacher avec n’importe quoi (même du sparadrap), tandis que le kinbaku se réfère directement aux jeux érotiques très codifiés avec des cordes. Et si l’actrice et réalisatrice Asia Argento n’hésite pas à poser ficelée sur son Instagram, d’autres, comme Iris Law, la fille de Jude Law, préfèrent l’allusion discrète au bondage avec des robes couture.
Daniele VenturelliMais il faut encore attendre la fin du XXe siècle pour que le BDSM ne soit plus inscrit au registre des psychopathologies. Comme si la violence n’avait pu s’exercer jusque-là que sous contrainte pour être légitimée… En 2021, les sciences sociales étudient un BDSM désinhibé pour ausculter les rapports de pouvoir, que ces jeux d’adultes consentants ne font que sublimer.
«On va souvent retrouver dans nos fantasmes et notre sexualité des enjeux de pouvoir, de violence et de transgression», note Zoé Blanc-Scuderi, pour qui il semble néanmoins rester un tabou: «J’ai l’impression que ceux qui fantasment la soumission, qu’ils soient hommes ou femmes, ont plus de mal à la revendiquer. Dans un système qui reste patriarcal et capitaliste, en valorisant le pouvoir, c’est toujours mieux vu de dire que l’on est celui ou celle qui domine.» Au point que dans les pays anglo-saxons, certaines dominatrices ouvrent des écoles pour celles qui veulent apprendre l’autorité au quotidien. A l’instar de Miss Erica Storm, Londonienne qui affirmait il y a peu au quotidien «Metro» être «en mission pour aider les femmes du monde entier à occuper l’espace». Alors négocier une augmentation grâce au BDSM, efficace?
«Quand on est Domina, on a une énorme responsabilité par rapport à la personne qui vient se soumettre, pour un temps donné, mais en même temps, on est respectée, admirée. On joue à être Dieu, précise Zoé Blanc-Scuderi. Et cette posture peut permettre de faire un transfert de compétences dans les habilités sociales quotidiennes, pour des femmes qui ont peu l’exercice du pouvoir dans la société.» Sur Netflix, en tout cas, elles sont reines.
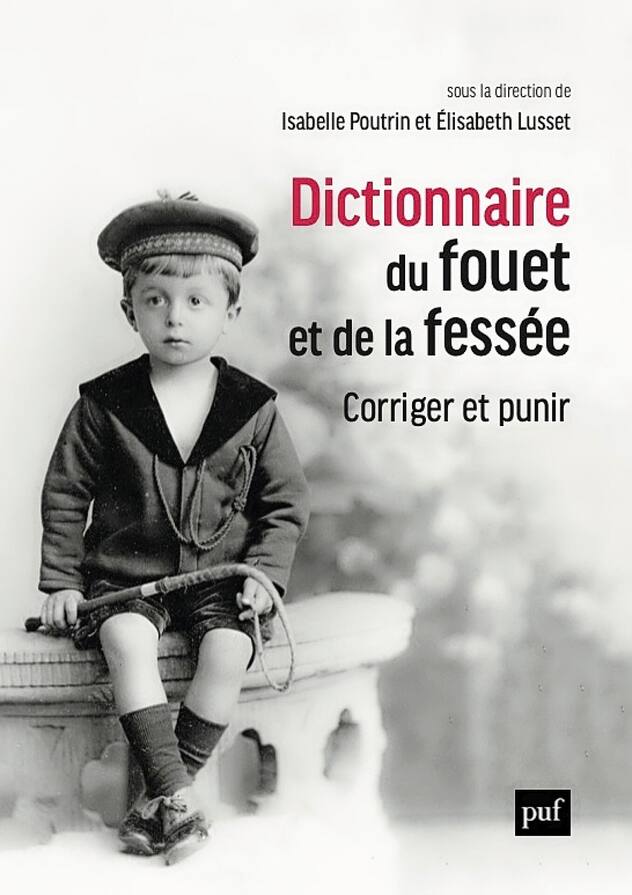
«Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir», Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset (dir.), Editions PUF.
DR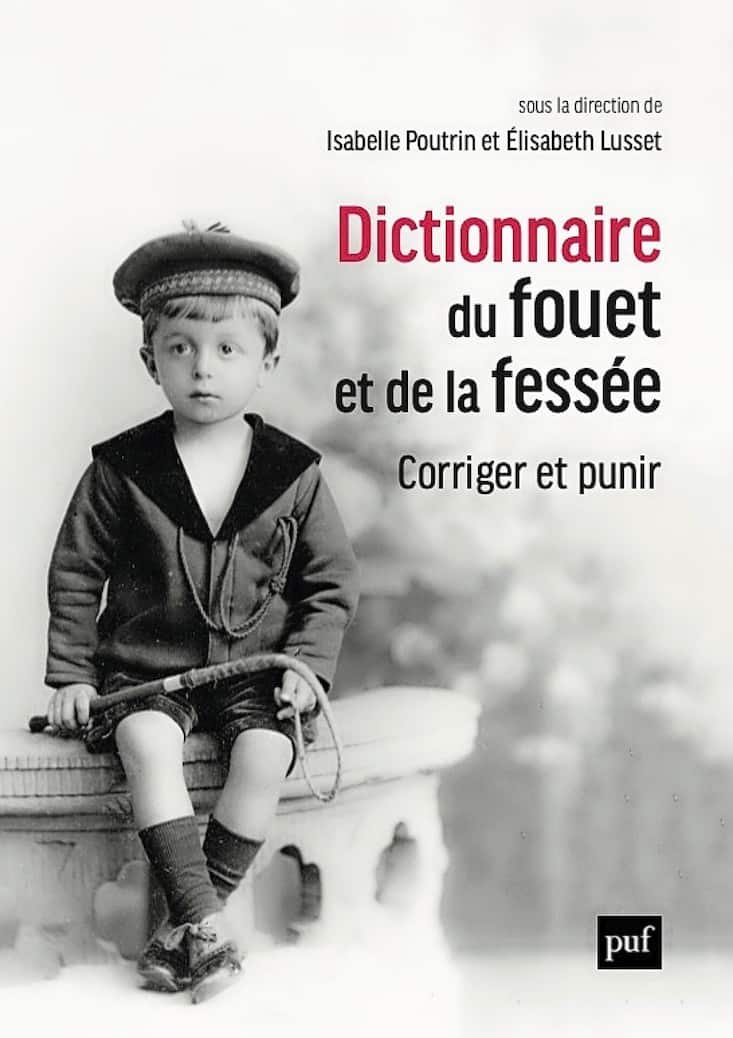
«Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir», Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset (dir.), Editions PUF.
DRPetites tortures ordinaires
La société a beau avoir toujours réfléchi à des punitions «justes», leur cruauté au fil du Dictionnaire du fouet et de la fessée interroge sur la violence des normes sociales. Florilège.
- Bonnet d’âne
Au XVe siècle, la «place de l’âne» est un lieu dans l’école où l’enfant puni est traité en âne, avec haillons et paille. Remplacée par des oreilles d’âne, toujours destinées à humilier, jusqu’aux années 1960.
- Cabinet noir
Au XIXe siècle, les enseignants peuvent envoyer l’élève dans un cachot. Parfois une simple salle vide… ou une sinistre caisse sombre et asphyxiante. La peine dure la journée et jusqu’à plusieurs jours.
- Camisole
Elle apparaît au XVIIIe siècle, alors que médecins et juristes cherchent à «humaniser» les corrections, en abolissant les chaînes. A la fin du XIXe, on commence à dénoncer son usage dans les asiles.
- Chevauchée de l’âne
Punition réservée au «mari battu ou cocu», coupable de ne pas avoir «tenu» sa femme. On le promenait dans le village, à l’envers sur un âne. Une sanction sociale destinée à défendre l’autorité patriarcale.
- Croquemitaine
Il apparaît dans la littérature enfantine au XIXe, pour effrayer les enfants. Il voit tout et débarque avec son martinet qui ne s’use jamais. Il coupe aussi la langue des plus récalcitrants ou les livre aux rats.
- Férule
Baguette en bois et cuir destinée à frapper les enfants à l’école. Son usage restait encadré, avec la liste des motifs «légitimes»: retard, bavardage… Les maîtres sadiques en abusaient.
- Rituel d’humiliation
Il y en a eu beaucoup… Dans l’Antiquité, à Sparte, les hommes célibataires sont «poursuivis et fouettés autour d’un autel par les femmes mariées», lors de séances d’humiliation publique.



