Bonjour,
Anne Parillaud: «L’abus fait partie de mon paysage depuis longtemps»
Quatre décennies de cinéma, une série télé («H24») sur TF1… Anne Parillaud n’a jamais quitté les projecteurs. Elle a pourtant pris le temps de s’enfermer pour écrire son premier roman, «Les abusés», une histoire implacable d’emprise amoureuse, qu’elle connaît bien. Rencontre.

Julie Rambal

Dans son premier roman «Les abusés» (Ed. Robert Laffont), l'actrice Anne Parillaud décrypte les mécanismes de la perversion narcissique.
Sylvie Lancrenon / éditions Robert LaffontC’est l’histoire d’un artiste très célèbre qui envoûte une femme, célèbre actrice aussi, au premier regard magnétique. Il la traite comme une impératrice, l’épouse, l’isole, la saccage. Parce que la maltraitance l’a condamnée dès l’enfance, elle laisse ce bourreau coloniser sa vie et son âme. Jusqu’à une fin fracassante. A 60 ans, Anne Parillaud signe son premier roman, «Les abusés» (Ed. Robert Laffont), qui décortique admirablement les mécanismes de la perversion narcissique, et rythme cette folie destructrice d’une écriture tantôt sensuelle, tantôt suffocante.
>> Lire aussi: Stars sous emprise dans leur propre couple
La divine Nikita, souvent présentée en muse de pygmalions célèbres, démontre qu’elle n’a rien d’une Galatée à travers ce récit hypnotique. On la rencontre dans les bureaux de l’éditeur, posée à une table où les livres à dédicacer se dressent en piles vertigineuses. L’auteure confie son émotion de les découvrir pour la première fois, incarnés après six ans de travail. Alors qu’elle est solaire et spontanée, difficile d’imaginer toutes les fêlures avec lesquelles elle cohabite. Mais les transformer en roman semble l’en avoir enfin affranchie. Echange avec une merveilleuse attachante.
- Ecriviez-vous déjà avant la parution de ce livre?
- Anne Parillaud: Je suis très attirée par la réalisation, mais j’avais envie de passer par le travail solitaire de l’écriture pour obtenir une légitimité de réalisatrice… et j’ai adoré. C’est même devenu obsessif. Je me suis retrouvée de 10 h à 2 h du matin à ne plus faire que ça, en ne voyant ni les jours, ni les semaines, ni les mois. J’aurais pu ne pas manger, me laver, dormir. Ma vie s’est arrêtée, mais sans aucun manque parce que ça s’est accordé à ma structure mentale. Pour la première fois, j’assumais quelque chose de profondément solitaire et personnel.
- Est-ce une prise de pouvoir?
- Une actrice se cache derrière son personnage, elle est l’outil d’un metteur en scène, alors que là, effectivement, il y a un sentiment d’acceptation de soi, et d’assumer ce qu’on veut dire. Même si, de façon assez curieuse, quand j’ai terminé la première version, j’ai été bouleversée de voir que je n’avais pas écrit le livre que je voulais, mais celui qu’il me fallait. J’ai raconté l’histoire que j’avais à l’intérieur de moi, mais légèrement désaxée. Mon inconscient a fait bouger le crayon. Je n’avais pas droit au mensonge, et il y aura un avant et un après ce livre.
- C’est-à-dire?
- J’ai l’impression que ça va consolider quelque chose qui va me donner confiance, un mot si difficile à associer à moi. Peut-être m’autoriser à m’accorder un peu plus de mérite qu’en tant qu’actrice, parce que je suis la seule responsable de ce livre.
- Votre histoire raconte la relation très violente d’une actrice sous l’emprise d’un pervers narcissique, mais le livre s’appelle «Les abusés». Pourquoi ce pluriel alors qu’il y a une victime évidente?
- L’abus est quelque chose qui fait partie de mon paysage depuis longtemps, et je voulais en parler, mais avec un regard qui ne soit ni la plainte ni le jugement. Je respecte cela, et chacun s’en sort comme il peut, mais j’ai essayé de comprendre. J’avais envie d’accorder aux deux une souffrance, car je pense qu’un bourreau, avant de l’être, est lui-même une victime. Dans les tribunaux, dès que l’on commence à fouiller la vie des bourreaux, on s’aperçoit vite que, dans l’enfance, il y a eu des drames, des abus, et que cela donne des êtres qui perdurent dans le mal. Même si les bourreaux font des actes terrifiants et condamnables, c’est important pour moi d’aller retrouver les racines du mal, que l’on reconnaisse la victime, pour faire ressurgir l’humanité.
- Pourquoi un tel besoin de comprendre l’origine du mal?
- Pour avoir été victime et avoir traversé des situations similaires, je voulais rentrer dans la fêlure de celui qui fait mal. L’observer, comme un rat de laboratoire, parce que je pense que les choses ont du sens. Quand on a été un enfant violé, battu, enfermé, comment cela peut-il faire un adulte qui veut le bien de l’autre? Jeune, je voulais être avocate, et j’ai mis cela dans l’héroïne: elle cherche à analyser son bourreau. Et je trouve que les avocats, les juges, les psychiatres, tous ces gens qui peuvent aider à élargir le jugement, doivent le faire, car c’est ce qui peut stopper un engrenage infernal. Lorsqu’on voit le phénomène historique qu’est la libération de la parole aujourd’hui, avec ce déferlement de témoignages, on s’aperçoit que c’est sociétal, et l’on ne peut pas juste dire: «OK, condamnez, sinon ça continuera et on n’aura rien réparé.» Il m’importait de dire qu’on est tous plus ou moins des abusés, c’est une question de curseur, et le bourreau n’est pas juste un monstre insensible. Il faut comprendre pourquoi il en est arrivé là. Evidemment avec une empathie sans borne pour les victimes, dont je fais partie.
- Car vous avez connu les mêmes situations d’emprise destructrices?
- Oui. Sûrement à commencer par mon père. Mais ce que je trouve intéressant dans la création, c’est de donner des passerelles pour permettre à chacun de s’identifier et de se projeter. Je n’avais pas envie de raconter mon autobiographie, même si c’est un sujet sur lequel je me trouve légitime, et que l’on n’écrit que ce qu’on connaît. L’auteur est toujours entre chaque phrase, il suinte de partout.
- La relation violente que vous décrivez va très, très loin…
- Je suis jusqu’au-boutiste, et j’ai poussé le personnage. Je décris la passion. Et, en cela, beaucoup de femmes peuvent se projeter, car la passion touche tout le monde. Elle est différente de l’amour. C’est un amour pathologique, une déviance, un excès. Personnellement, je ne peux pas m’en passer. Je suis une passionnée, pour tout. La passion entraîne dans une folie. Si l’on ne sait pas l’arrêter à temps, elle peut conduire à des actes terrifiants, et j’ai amené mon héroïne jusque-là. Mais il faut parfois se perdre et aller au bout de la douleur, pour trouver son chemin, pour que le choc soit si fort que cela remette en place. A la fin, son problème n’est pas réglé, mais elle comprend ce qu’elle ne veut plus subir.
- Mais vous êtes déjà allée aussi loin dans la souffrance amoureuse?
- Les artistes sont des prédateurs. C’est-à-dire que notre matériel est notre vie, nos sensations, et que l’on est prêts à beaucoup. En recevant un César, j’avais dit que j’étais prête à n’importe quoi pour vivre une émotion. Je n’ai pas changé. Je suis prête à beaucoup pour expérimenter mes limites, en espérant qu’elles soient le plus éloignées possible. J’ai cet état de survivant que l’on ne peut pas mettre à terre, car il a déjà survécu.
- Derrière ce roman, on ne peut pas s’empêcher de penser à votre divorce avec Jean-Michel Jarre. A l’époque, en 2011, vous disiez dans Paris Match que vous le viviez «comme quelqu’un de structure fragile, blessé, vulnérable et crédule… proie idéale et aisément manipulable pour une sorte de prédateur sans pitié».
- Je peux redire exactement la même chose, et redire que, dans ma vie, j’ai été amenée, parce que je suis construite comme cela, à être une proie facilement manipulable pour des gens dont c’est la motivation. Mais sans citer personne, car c’est quelque chose de général et constitutif de moi. Quand je dis qu’il y aura un avant et un après ce livre, c’est qu’en l’écrivant j’ai pris conscience de choses. Vous écrivez et, quand vous relisez, vous réalisez que quelque chose est exorcisé.
- Dans votre livre également, l’héroïne a été abusée par son père. C’est votre cas?
- Vraisemblablement. Mais c’est un flou complet. Et c’est là où l’écriture est une vraie catharsis de l’inconscient. Je pense que le fait d’avoir écrit sur cette héroïne atteinte du syndrome de Stockholm correspond au déni qui m’a permis de survivre. Je n’ai pas pu condamner mon père et je suis tombée dans un autre syndrome: celui d’aimer son bourreau.
>> Lire également: «Le silence ne profite qu’aux bourreaux, pas aux victimes d'inceste»
- Vous n’avez jamais voulu faire de thérapie pour lever le voile?
- Non. J’ai construit un équilibre très fragile sur un énorme déséquilibre. Et je ne sais pas ce qu’il se passerait si j’allais fouiller dans le décompte des souvenirs. Est-ce que tout l’échafaudage s’écroulerait? A travers mes rôles, et aujourd’hui cette héroïne, je prends un autre chemin. J’utilise des tiers, qui sont comme des facettes, pour me protéger.
- Vous évoquez l’absence totale de confiance en soi de l’héroïne, «enfermée dans une peau de haine». C’est votre cas? N’êtes-vous pas arrivée à une cohabitation douce avec vous, au fil du temps?
- Non. J’ai un rapport à moi-même très compliqué, et si je m’appréciais un peu plus, je ne courrais pas autant après une quête de perfection permanente. Je me trouvais toujours des excuses, en me disant: «C’est normal de ne pas m’aimer parce que ci, ça…» Et puis est arrivé Nikita. Et des gens ont reconnu un film, un rôle, un César. Mais quand moi, j’ai vu Nikita, je suis sortie en pleurs de m’apercevoir que je ne m’aimais toujours pas, malgré tout cela, et que je n’arrivais pas à voir s’il y avait du talent, de la puissance, une valeur. Et j’ai compris ce jour-là que c’était mort, que je n’arriverais jamais à m’apprécier. J’ai même voulu arrêter le cinéma. Avant de me dire que l’amour que les gens portaient à Nikita, pas à moi, je pourrais en vivre. Et c’est ce qui se passe. Le retour sur mon travail me nourrit. Et cette faille m’offre un matériel pour créer. J’ai même le grand privilège de pouvoir vivre des catharsis.
- Ce livre, c’est votre #MeToo?
- Oui et non. Autant j’adhère à la démarche, autant je n’ai jamais été une porte-drapeau. J’essaie de faire passer des messages dans ce livre, qui sont concomitants au mouvement d’aujourd’hui, mais par hasard puisque j’ai démarré l’écriture il y a six ans. Le livre sort au moment où l’on est sur les mêmes dossiers, c’est le destin. Et, du coup, c’est complémentaire. Toutes les formes de voix sont les bienvenues.
- Alain Delon, Luc Besson… Certains de vos compagnons étaient des hommes de pouvoir. Cela ne facilite-t-il pas certains rapports de domination?
- Ce sont des hommes puissants et j’aime la puissance parce qu’elle résonne la plupart du temps avec intelligence. C’est-à-dire que ce sont des gens qui ont construit et maîtrisé une partie de leur existence, et je suis admirative de cela. Je suis effectivement tombée sur des personnages avec un esprit avide, où les neurones circulent. Cela a été des pygmalions puisqu’ils m’ont dirigée, engagée dans leur film, et j’ai appris beaucoup à leurs côtés. J’aime la réussite dans ce qu’elle a de volonté, d’acharnement. Etre auprès de ces gens-là, c’est être nourrie, dans une émulation. Et puis pour quelqu’un, comme moi, qui ne se met pas de valeur, ils vous en donnent une puisque ce sont des gens reconnus qui s’intéressent à vous.
- Votre ouvrage contient quelques références mystiques. Vous avez la foi?
- Oui, mais je ne sais pas comment je l’appelle, ni si c’est quelqu’un ou une force. Les valeurs que demande la foi me conviennent. C’est avoir l’humilité de se dire serviteur de sa vie et non pas maître. Et ça empêche l’amertume, le sarcasme. On accepte son parcours, on accepte de vivre des choses douloureuses en sachant qu’il y a des choses merveilleuses, que c’est un assemblage, et qu’on ne sait pas où on va. Et cette humilité déploie un imaginaire beaucoup plus grand que si on était dans la maîtrise de tout. Parce que si on savait où on allait, on s’ennuierait beaucoup.
S’il y avait un seul… livre
«Résurrection», de Léon Tolstoï. «Ce livre m’avait bouleversée. C’est ça la puissance: quand vous rencontrez quelqu’un qui dit ce que vous auriez aimé dire, c’est une fulgurance», dit Anne Parillaud.

Ce document a été créé et certifié chez IGS-CP, Charente (16)
IGS-CP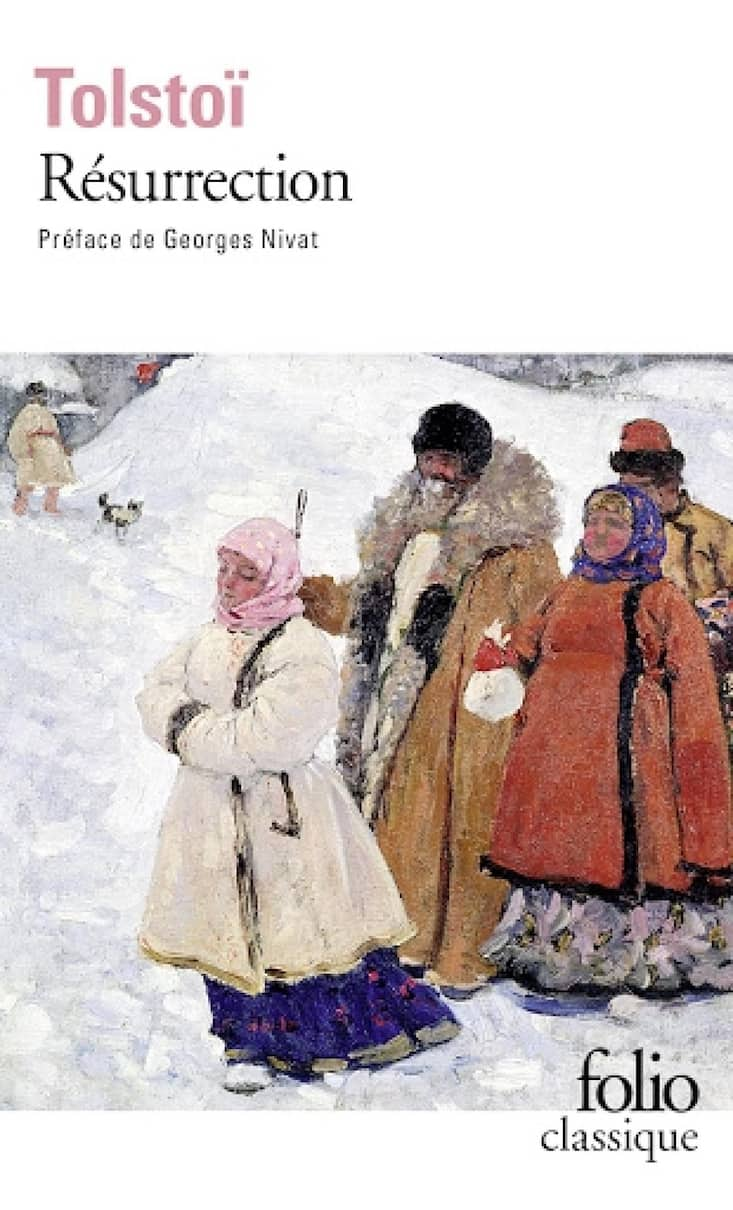
Ce document a été créé et certifié chez IGS-CP, Charente (16)
IGS-CP